
Gisant d’Aliénor d’Aquitaine. Fac-similé Ce gisant, conservé à l’abbatiale de Fontevrault (Maine-et-loire), est daté entre 1210 et 1215. Inhumée à l’abbaye de Fontevrault où elle avait terminé sa vie, Aliénor y est entourée de son second mari Henri Il Plantagenêt, de leur fils Richard 1er Cœur de Lion (tous deux ducs d’Aquitaine et rois d'Angleterre) et de leur fille Jeanne. Le gisant placé sur le tombeau Représente l'image de la défunte sur son lit de mort : Aliénor tient un livre dans ses mains, bien qu’elle semble plutôt assoupie. Décédée à plus de 80 ans, le temps paraît l’avoir épargnée, et son expression est empreinte de sérénité. La sculpture originale comporte encore les traces de peinture (bleue et blanche pour son vêtement, rouge pour le drap), non reproduites ici. Figure historique marquante de l'Aquitaine, mais aussi de la France, de l’Angleterre et de l’Occident médiéval, Aliénor joua également un grand rôle dans la diffusion de la poésie courtoise et fût ainsi considérée comme la « reine des troubadours ».
57

Vitrail aux armes de Bordeaux et d'Angleterre Chapelle Notre-Dame-de-la-Rose de l’église Saint-Seurin de Bordeaux siècle Ces vitraux provenant de la Chapelle Notre dame de la Rose de l’église Saint Seurin de Bordeaux consacrée en 1444 par l’archevêque Pey Berland illustrent la qualité des productions gothiques de l’époque dont on admire ici les tons profonds et lumineux. Les armes de la ville portent ici les trois léopards d’Angleterre que l’on retrouve représentée sur l’autre vitrail également.
58

59

Ce dernier présente les armes d’Henri IV de Lancastre qui adopta à partir de l’année 1405 aux deux quartiers français de son blason les armes à trois fleurs de lys en lieu et place du semis. Nous voyons ici symbolisé l’attachement de la Ville et de l’archevêque à l’autorité du Roi-Duc.
60

Remplage de La rosace de l'église des Grands Carmes de Bordeaux Art gothique flamboyant. Calcaire Cette rosace est constituée de douze rayons et d'un décor basé sur un système de trois carrés décalés régulièrement. 1 Les écoinçons déterminés ainsi sont eux-mêmes ornés de « lancettes » plus pu moins aiguës. Ce décor se différencie nettement des « roses » de Bordeaux qui lui sont contemporaines.
61

Monument funéraire de Michel de Montaigne. Vers 1593 Calcaire Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) appartient à une famille de marchands établie à Bordeaux au XVe siècle et récemment anoblie. Conseiller au parlement, il se retire en 1571 dans son château et y compose les Essais parus en 1580 et complétés en 1588. Durant les Guerres de religion. Montaigne devient contre son gré maire de Bordeaux de 1581 à 1585 et parvient à maintenir la paix dans sa cité. Le monument funéraire, exécuté vers 1593 par les sculpteurs bordelais Prieur et Guillermain, présente un gisant d’allure médiévale, qui convient davantage à l’homme public de condition nobiliaire, qu’au philosophe. Le piédestal s’orne de motifs délicatement ciselées où apparaît l’art maniériste. Monument déplacé sous la Révolution puis revenu aux Feuillants devenus lycée (18G3), il prend place dans le hall de la Faculté des Lettres édifiée, sur ce même terrain à partir de 1882. Des deux langues, choisis la plus proche du gascon. Les clés sont les lignes, les lettres aux extrémités : les consonnes à gauche, les voyelles à droite, Mon tout : le fin mot de la vie du philosophe Gauche: ?-11-8-1 Droite : 11-10
62

Monument funéraire de Michel de Montaigne.
63

Monument funéraire de Michel de Montaigne.
64

Monument funéraire de Michel de Montaigne.
65

Abri sous roche consolidé par des poteaux en béton.
66

Entrée de la grotte. La grotte de Pair-non-Pair est découverte en 1881 par François Daleau. Les gravures totalement recouvertes par les couches archéologiques sont reconnues en 1896. Troisième grotte ornée découverte, elle ne sera jamais remise en cause et sera un des arguments pour la reconnaissance d'un art préhistorique. Les occupations humaines sont datées du Moustérien (- 80 000 ans environ), du Châtelperronien (- 40 000 ans), de l'Aurignacien (- 30 000 ans) et du Gravettien (autour de - 25 000 ans). Précurseur par ses méthodes de fouilles et de relevés, F. Daleau nous a laissé ses carnets où il notait minutieusement toutes ses observations sur la stratigraphie ou la répartition spatiale des objets.
67

Entrée de la grotte, intérieur. François Daleau révèle l’un des premiers témoins incontestables de l’expression pariétale préhistorique. Grâce à son insistance, Pair-non-Pair devient, en 1900, la première grotte classée au titre des monuments historiques, au moment de son acquisition par l’État. Le travail de François Daleau constitue une des premières fouilles scientifiques d’une grotte préhistorique. Il y déploie des méthodes innovantes : le déblaiement progressif des couches archéologiques qui comblent la cavité et le fait de noter les objets et les restes osseux dans ses fameux carnets d’excursions.
68
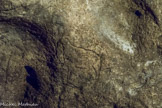
Un bouquetin. Les premières gravures, aperçues dès 1883, sont identifiées en 1896. En les rapprochant des niveaux archéologiques, des industries lithique et osseuse, François Daleau les date de la période aurignacienne (entre -33000 et -26000 ans). Les six mille ossements découverts ont permis d’identifier près de soixante espèces animales. De très nombreux carnivores : ours des cavernes, loup, renard, blaireau, putois, panthère et lion des cavernes, hyène, mais aussi sanglier, renne, cerf, mégacéros, daim, aurochs, bison, chamois, cheval, lièvre et lapin, taupe, hérisson. Le rhinocéros, le mammouth faisaient également partie de l’environnement des hommes de Pair- non-Pair qui chassaient aussi les oiseaux : oies, canards, goélands, perdrix, pigeons, aigles, vautours... Certains sont représentés sur les parois de la caverne. Le bouquetin est le plus fréquemment gravé mais ses os n’ont été retrouvés, ni ici, ni dans aucun gisement préhistorique en Gironde. La hyène a fréquenté de manière assidue la grotte, mais seulement en l’absence des humains.
69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84