Conflans. Parc Olympique.
Conflans : le quartier médiéval ; le Musée d’Art et d’Histoire ; L'église Saint-Grat. Albertville : le Parc Olympique.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42
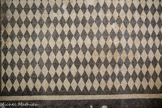
43

44
![<center>Conflans : Musée d’Art et d’Histoire.</center> Depuis la fin du Néolithique, les Alpes savoyardes ont été des lieux de passage et d'invasion. De nombreux peuples s'y sont même installés: les Ceutrons en Tarentaise, les Graiocèles et les Médulles en Maurienne, les Allobroges arrivés au Vème siècle avant J.C.
Au IIème siècle avant J.C, les Allobroges sont battus une première fois par les armées Romaines mais les nombreuses révoltes qui s'ensuivirent et le désintérêt de Rome pour les routes alpines permirent à ce peuple d'origine celtique de garder son indépendance.
Tout a changé avec la conquête de la Gaule: en effet le contrôle des Alpes est vite devenu une nécessité et de fait, vers l'an 15 avant J.C., les peuples alpins furent soumis les uns après les autres à l'autorité de Rome.
Une fois conquise, la Savoie fut partagée en trois provinces: Gaule Narbonnaise, Alpes Graies et Alpes Cottiennes. Le Pagus [district] Vale , probablement centré sur le site d'Albertville, dépendait comme le reste du territoire allobroge de la cité de Vienne, elle-même intégrée dans la Gaule Narbonnaise.](./thumbnails/savoie-5-7228.jpg)
45

46

47

48

49

50

51

52
![<center>Conflans : Musée d’Art et d’Histoire.</center> Naissance d'une ville : Albertville.
Occupé dès la période romaine, le site de Conflans devint très vite stratégique politiquement et économiquement. Une cité y prospéra derrière ses remparts, point de passage obligé pour remonter la vallée de la Tarentaise. Au XIIIème siècle, les comtes de Savoie créèrent en contre bas, dans la plaine, une ville neuve : L’Hôpital-sous-Conflans.
Jusqu'à la fin du XVIIIème siècle, Conflans domina sans conteste sa voisine sans cesse en proie aux inondations de l'Arly. La décision d'endiguer l'Arly et l'Isère et de faire passer une route dans la vallée fut fatale à Conflans mais provoqua le développement de sa rivale. En 1835, le roi de Pièmont- Sardaigne, Charles-Albert décida de réunir les deux entités sous le nom d'Albert-Ville [Albertville]. Une ville à la montagne était née, ville qui fut érigée au rang de sous-préfecture après le rattachement de la Savoie à la France, en 1860.](./thumbnails/savoie-5-7239.jpg)
53

54

55

56

57

58
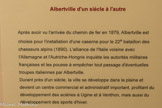
59

60

61

62

63

64

65

66

67
![<center>Conflans : Musée d’Art et d’Histoire.</center> BRAS RELIQUAIRE de SAINT GRAT.
Argent repoussé sur âme de bois, XVe siècle.
Le reliquaire est destiné à recevoir les reliques d'un Saint, c’est-à-dire tout ce qui reste de lui après sa mort (ossements, cendres, vêtements ou out objet utilisé durant sa vie sur terre).
Contre la condamnation du Culte des Reliques des Saints par les Protestants, le Concile de Trente (XVIe siècle) réaffirma non seulement le droit, mais aussi le devoir de tout catholique d'honorer les Saintes Reliques. Ce culte est d’autant plus légitime et nécessaire pour Rome que Dieu glorifie lui-même les Reliques par de merveilleux privilèges et d'innombrables miracles.
Le reliquaire de Saint Grat renferme un fragment d'os du bras du Saint. L'inscription gothique mentionne que « Le Révérend Père Seigneur Oger, évêque d'Aoste, fit faire [ce reliquaire] en l'honneur de Saint Grat, l'an 1432. Qu'il se réjouisse avec les bienheureux ». Ce reliquaire en forme d’avant-bras fut offert](./thumbnails/savoie-5-7261.jpg)
68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170