Le Tramway du Mont-Blanc. Saint-Nicolas-de-Véroce. Saint-Gervais-les-Bains.
Le Nid d’Aigle par le Tramway du Mont-Blanc, le glacier de Bionnassay. L'église Saint-Nicolas-de-Myre à Saint-Nicolas-de-Véroce. Saint-Gervais-les-Bains : Église Notre-Dame-des-Alpes au Fayet et l'Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133
![<center>Saint-Gervais-les-Bains : Eglise Notre-Dame-des-Alpes au Fayet.</center> Dans la décision de la commission d’architecture religieuse de l’évêché d’Annecy, qui a étudié le 9 février 1935 les projets présentés pour Le Fayet, on perçoit ce désir du clergé de construire une église contemporaine et non une copie d’un temple ancien. Le projet de Novarina est choisi parce qu’il «prévoit l’intérieur moderne traité selon la conception actuelle», qu’il
s’harmonise «très bien avec le cadre local»
et «présente une heureuse homogénéité d’architecture moderne». La future église de
Novarina sera «une œuvre remarquable dont le caractère principal est
d’être régional [...]. L’architecture s’est inspirée de la nature majestueuse du cadre.](./thumbnails/savoie-2-6560.jpg)
134

135

136

137

138

Ces vitraux illustrent, à gauche, la vie de la Vierge Marie : l'Annonciation avec dans les trois vitraux centraux de la rangée du bas, Marie, la colombe du Saint Esprit et l’archange Gabriel,
139

«Le Mariage de la Vierge» : les vitraux latéraux de la Vierge et de Saint Joseph sont prolongés dans le vitrail central par la représentation de leurs mains unies par le prêtre.
140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166
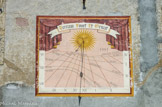
167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177