La Bastille de Grenoble. La Maison Bergès.
Le téléphérique et La Bastille à Grenoble. Le Mémorial National des Troupes de Montagne sur le Mont Jalla. Le Musée des Troupes de Montagne. Villard-Bonnot avec la Maison Bergès, siège du Musée de la Houille Blanche.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Turbine à volant, 1890-95. Diam : 2,14 m, fonte Jet centripète, 650 cv, 430 t/mn. Cette turbine installée sous la chute de 500 m du Vors actionnait des machines électriques. Elle est à aubage rapporté, ce qui permet le remplacement de celui-ci en cas d'usure. On peut d'ailleurs observer une rupture des aubes sur la moitié de la circonférence de la roue due probablement à l'emballement de la turbine.
42

43

44
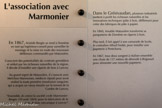
45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Etudiant à l'Ecole centrale, Aristide Bergès s'était intéressé aux turbines et avait proposé, en devoir de vacances, des modifications de la turbine inventée par Benoît Fourneyron en 1827. Avec cette innovation, Fourneyron permettait le passage de la roue en bois à la roue métallique d'où dériveront tous les modèles de turbines, dont la turbine-parapluie dessinée par Aristide Bergès pour son usine.
71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86
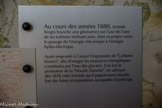
87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

Moulages en plâtre. De gauche à droite : Tête de l'Apollon du Belvédère, Tête de l'Agrippa de Gabies, Tête antique.
103

104

105

106

107

108
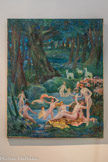
109

110

111

Fleurs des champs et des jardins.
Destiné à embellir les murs, le papier peint exulte dans l’art du motif, de la couleur et de matière. Parmi les motifs les plus courants, celui de la fleur traverse les modes. Belle, subtile, colorée, cette dernière se prête à merveille au jeu de la composition. Elle permet des combinaisons variées, bien lisibles et adaptées à la planéité des murs. Elle s’adapte à l’étroitesse des lés qui doivent se raccorder latéralement, interdisant ainsi l’usage de motifs larges et amples. De la fin du XVIIIe siècle jusqu’aux années 1890, la fleur naturelle, qu’elle soit des jardins ou des champs, honore les murs. La rose triomphe au milieu du XIXe siècle et sous le Second Empire, mais la mode des jardins d’hiver incite également les fabricants à imaginer une flore riche et foisonnante aux colorations somptueuses. En réaction à cet art naturaliste, le mouvement artistique anglais Arts and Crafts puis celui de l’Art Nouveau introduisent, dans la dernière décennie du XIXe siècle, une esthétique nouvelle basée sur une stylisation poussée des motifs et de leur représentation en deux dimensions. Cette tendance se poursuit dans les années 1925 avec le style Art déco, de façon encore plus exubérante et décorative.
112

Papier peint à motif de chinoiserie. Manufacture Réveillon, Paris, vers 1789. Papier rabouté, sans fond, impression à la planche, 8 couleurs. Coll. Musée du Papier peint, Rixheim. Le raffinement caractérise cette composition d'inspiration chinoise. De fines guirlandes de fleurs rejoignent de petits îlots flottants. Un personnage est assis sous un parasol près d'un escalier, dans un environnement végétal constitué de bosquets et d'arbres en fleurs.
113

114

Papier peint à motif de raisins et de fruits. Société française des Papiers peints, Balagny-sur-Thérain (Oise), 1925. Papier continu, fond gris clair, impression mécanique, 4 couleurs dont poudre dorée. Coll. Bibliothèque Forney, Paris. Les fruits remplacent ici les fleurs. Les motifs sont rehaussés de poudre dorée qui donne à la composition un aspect précieux. L'art naturaliste du XIXe siècle
115

Paravent de quatre feuilles à décor de papier peint panoramique Palais Royal. Manufacture inconnue, France, 1810-1820. Papier rabouté, fond mat, impression à la planche, 5 couleurs. Coll. Musée du Papier peint, Rixheim. L’usage de paravents en papier peint est courant aux XVIIIe et XIXe siècles. Chaque feuille présente une composition similaire: aplat de couleur bleue en partie basse, scène en camaïeu de gris au centre, arcade de feuillage en partie haute, le tout flanqué de fines colonnettes autour desquelles vient s’enrouler une branche de feuillage. Les quatre lés assemblés sont une partie d’un panoramique de vingt lés, représentation amusante et vivante des jardins du Palais Royal à Paris.
116

L’art de l’imitation. Indiennes, soieries, damas. Dès le XVIIIe siècle, les fabricants de papiers peints cherchent à imiter les tissus d’ameublement, alors réservés à l*aristocratie car très coûteux. Les nombreux brevets d’invention déposés entre la fin du XVIIIe et le milieu du XIXe siècle, témoignent d’une véritable dynamique en matière d’innovation et de perfectionnement dans ce domaine. Les productions se diversifient et offrent des rendus, des textures et des modelés de plus en plus subtils et réalistes qui répondent aux demandes d’une bourgeoisie éprise d’un luxe ostentatoire, à moindre coût L’impression en “tontisse” mise au point au début du XVIIIe siècle, permet l’imitation des velours de Gêne, alors réputés; l’impression en taille-douce, celle de tulle ou de tapisserie. Les fonds irisés (dégradés) ouvrent la voie à la copie des soieries lyonnaises, en restituant leur aspect soyeux et vibrant. Enfin, les techniques de lissage, satinage et gaufrage apportent brillance, reflet et profondeur aux motifs de damas, passementerie, broderies ou autres étoffes façonnées. Grâce à leur savoir-faire, les manufactures parisiennes Jean-Baptiste Réveillon (1753-1792), joseph Dufour (1797-1822) et Paul (1863-1898), acquièrent une solide réputation dans cet art de l'imitation.
117

Papier peint à motif d'indienne. La Danse des noirs. Manufacture Réveillon, Paris, 1787. Papier rabouté, sans fond, impression à ta planche, 6 couleurs Coll Musée du Papier peint, Rixheim. Importés des Indes dès la fin du XVIIe siècle, les chintz ou indiennes sont des cotonnades à motifs peints, très à la mode en Europe au XVIIIe siècle. La manufacture Oberkampf à Jouy-en-Josas, près de Paris, se distingue dans la fabrication de ce produit de luxe connu sous le nom de toile de Jouy. Ce papier peint reprend le dessin d’une toile de Jouy créée en 1784. Cinq personnages au visage coloré font la ronde autour d’un palmier, accompagnés d’un musicien. La présence des deux drapeaux et du bonnet au sommet de l’arbre laisserait penser qu’il s’agit là d’une scène d’affranchissement d’esclaves. Le décor composé d’arbres exotiques, d'une hutte et d’un pécheur sur une pirogue, contribue à situer cette scène dans une contrée tropicale. Pour donner l’illusion de la toile, le motif a été imprimé directement sur le papier brut, sans coloris de fond.
118

Papier peint à motif de damas. Manufacture Réveillon, Paris, 1781. Papier rabouté, fond lissé, impression à la planche, 2 couleurs Coll. Musée du Papier peint, Rixheim. Ce motif de damas reprend un modèle de soierie lyonnaise. Il a été imprimé par la manufacture Jean-Baptiste Réveillon à Paris, alors très réputée, qui devient manufacture royale en 1783. Le lissage donne ici l'illusion de l'aspect brillant de la soie. Cette opération consiste à polir, sur toute ta surface, l’envers du papier avec une pierre d’agate ou un galet de cuivre.
119

120

121