
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Orné d’une façade divisée en trois travées verticales par des pilastres décorés de chapiteaux corinthiens, le corps de logis répond au type de l’hôtel particulier traditionnel, situé entre cour d’honneur à la vente et jardins à l’arrière. Au sommet de la façade, le fronton triangulaire est frappé du blason des propriétaires.
57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

Buste de Gabriel Naudé, par raymond Gayrard. Marbre, 1824. Depuis la fin de l'année 1642, Gabriel Naudé était entré au servicede Mazarin et avait entrepris pour son nouveau maître de concevoir et de développer la plus belle et la plus volumineuse bibliothèque que l'Europe ait connue.
114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128
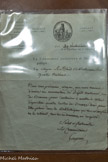
129

130

131
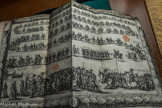
132

133

134

135

136

137

138

139

140

141
